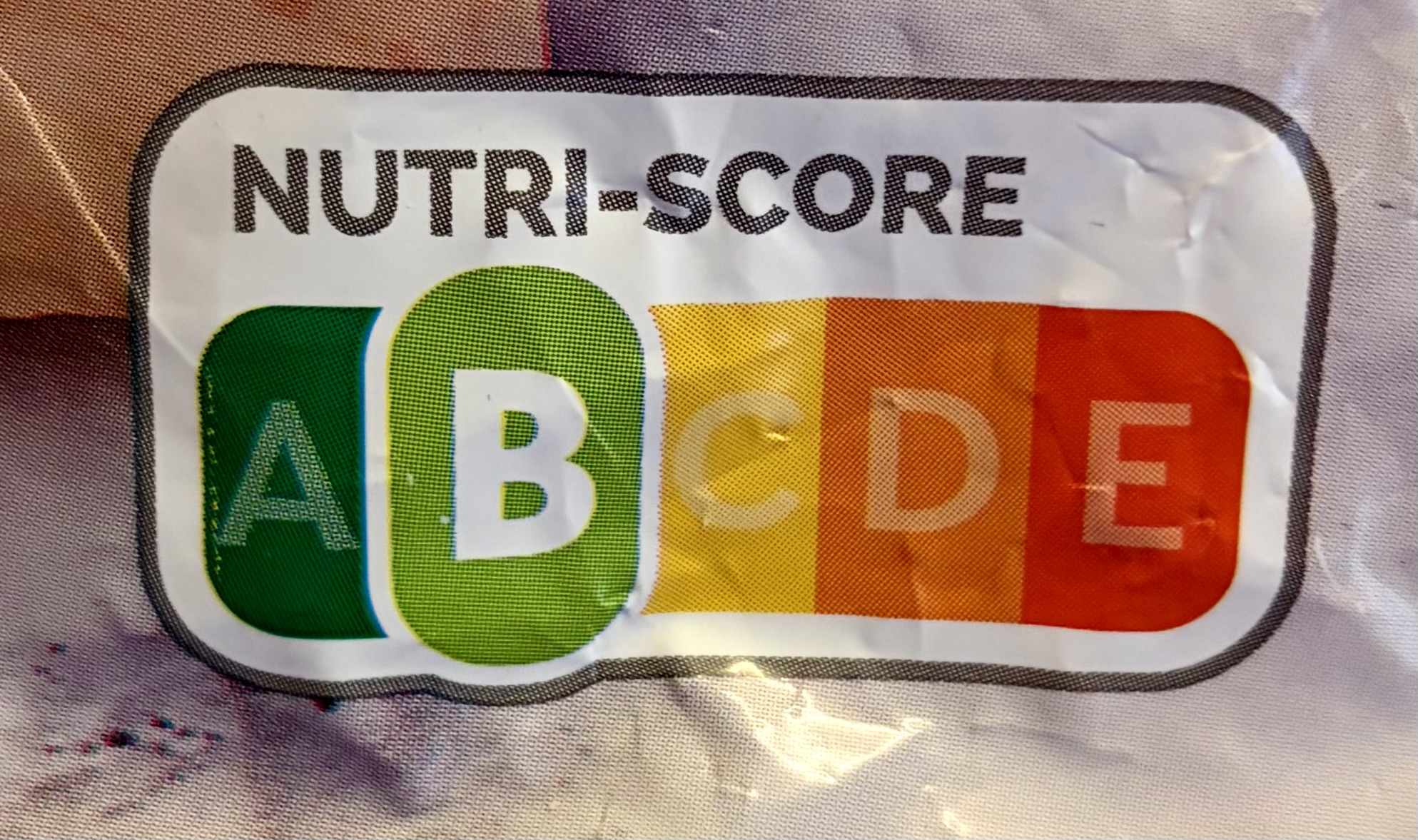Le concept de séparation des pouvoirs, développé par Locke et Montesquieu, est particulièrement ancré dans la culture institutionnelle française : chaque pouvoir, législatif ou exécutif, comme l’autorité judiciaire, ne peut en principe empiéter sur les compétences propres des deux autres.
On écartera bien évidemment de cette remarque l’activité de contrôle du Gouvernement exercé par le Parlement, essence même du régime parlementaire, ou encore l’autorité du ministre de la Justice sur le Parquet.
En revanche, sauf cas bien précis, et limités notamment aux aspects liés aux opérations de gestion privée (par exemple, gestion patrimoniale du domaine privé de l’État ou des collectivités locales) les tribunaux de l’ordre judiciaire ne peuvent juger des actions des personnes de droit public. De même en France, le Gouvernement ne peut interférer dans le fonctionnement et l’administration internes du Parlement (même lorsqu’il s’agit du budget des Chambres, du contrôle de leurs comptes, du maintien de l’ordre dans l’enceinte des assemblées, ou de la gestion de leurs fonctionnaires), et en retour le Parlement ne peut déterminer, ni la composition interne du Gouvernement, ni la répartition des compétences entre ministères, ni donner des injonctions aux ministres, même par le biais de la Loi.
C’est pour cette raison qu’en France le Parlement, ou plus précisément chacune des Chambres qui le composent, en ce qui la concerne (l’Assemblée nationale et le Senat) dispose, s’agissant des pouvoirs de police et de sécurité, d’une complète autonomie, sous l’autorité de son Président, s’agissant de son fonctionnement interne, du droit d’édicter son propre Règlement, et de la capacité de prononcer lui même des sanctions en cas de violation de celui-ci.
Jusqu’en 1958, le Règlement était applicable dans l’assemblée considérée, du seul fait de son adoption. La Constitution du 4 octobre 1958 a cependant instauré un contrôle préalable de sa conformité, ou de celles de ses modifications successives, avec la Constitution. Ce contrôle est exercé par une autorité indépendante, le Conseil Constitutionnel, pour lequel il convient de relever que six des neuf membres nommés qui le composent le sont par les présidents des assemblées parlementaires eux-mêmes.
Détenant, sous cette réserve de la conformité à la Constitution, une totale liberté pour définir son Règlement et en appliquer les dispositions, chaque assemblée parlementaire est également maîtresse de l’adoption de son Instruction Générale, qui détaille les conditions de mise en œuvre de son Règlement, ainsi que des moyens de les faire respecter, notamment par ses membres et son administration, et si besoin est, de sanctionner les manquements qui pourraient se manifester, qu’ils viennent des membres de la Chambre, des fonctionnaires parlementaires, des collaborateurs divers ou encore du public présent dans l’enceinte de la Chambre.
Il a été longtemps considéré que les sanctions décrétées par les autorités habilitées du Parlement ne pouvaient pas faire l’objet de contrôle juridictionnel de la part des tribunaux de l’ordre administratif, ceux-ci jugeant naguère les actes et décisions du seul pouvoir exécutif. En revanche, pour les cas les plus graves de mise en accusation du Président de la République, c’est le Parlement qui dispose du pouvoir de juger le Chef de l’Exécutif. Hormis cette hypothèse rarissime, le principe demeure cependant pour l’instant qu’exécutif, législatif et judiciaire n’empiètent pas l’un sur l’autre et que ce principe demeure pour empêcher le contrôle de la légalité ou de la proportionnalité des sanctions internes visant les parlementaires lorsqu’ils enfreignent le Règlement ou l’Instruction Générale.
Nous verrons que ce principe d’exclusion a connu, notamment depuis une trentaine d’années, de larges exceptions pour ce qui concerne en tous cas les sanctions d’ordre administratif, telles que les décisions individuelles portant sur les marchés publics passés par le Parlement, ou celles visant les personnels parlementaires, notamment dans le cadre du régime disciplinaire. Et s’agissant des mesures prononcées par une Chambre à l’encontre de l’un de ses membres, il sera intéressant à cet égard de voir quelle réponse apportera le tribunal administratif de Paris quant à la recevabilité d’un recours introduit fin 2014 par un député aux fins d’obtenir l’annulation d’une sanction individuelle (rappel à l’ordre et réduction d’ ¼ de son indemnité pour un mois) qui lui a été imposée par la présidence de séance de l’Assemblée nationale, et confirmée par le Bureau de l’AN. Cependant, toutes ces limitations, nouvelles et limitées quant à leur nombre et à leur portée, ne remettent pas en cause la suprématie du Parlement dans son administration interne.
En revanche, le Parlement ne dispose plus, depuis la Constitution de 1958, du droit de contrôler lui-même la validité des mandats donnés par le suffrage universel aux membres des assemblées. Ce rôle est désormais échu au Conseil Constitutionnel, qui juge en première et dernière instance des contentieux électoraux, s’agissant des élections à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Il faut reconnaître que des abus s’étaient autrefois produits : c’est la Chambre des députés elle-même (nom à l’époque de la Chambre basse) et non une Cour qui, en 1939, qui révoque par un vote de la majorité de ses membres les mandats des députés du groupe « ouvrier et paysan » qui réunit les élus communistes après la dissolution de leur parti suite au pacte germano-soviétique ; sous la IVe République, entre 1946 et 1958, l’Assemblée nationale vérifie elle-même la validité des mandats de ses membres au début de chaque législature, et ce contrôle n’était pas toujours exempt d’arrière-pensées politiciennes.
Nous examinerons successivement les compétences du Parlement en matière de sécurité, ainsi qu’en matière de sanctions à l’égard de ses membres et de ses collaborateurs. Nous verrons également que le président de chaque chambre dispose de la maîtrise de l’accès à l’enceinte de l’assemblée qu’il préside, que les assemblées sont garantes de l’immunité de leurs membres, et disposent seules du droit de lever ce privilège, comme de celui d’obtenir la libération d’un parlementaire détenu, en requérant sa présence dans son assemblée. Dans certains cas graves, des juridictions spéciales, largement composées de parlementaires, sont appelées à juger le Président de la République ou les ministres. Enfin, le Parlement dispose d’une suprématie sur les procédures et décisions du pouvoir judiciaire, avec les lois d’amnistie.
Par commodité, le régime applicable à chaque Chambre étant pratiquement identique, le terme « Parlement » sera utilisé indistinctement pour parler de chacune des Chambres qui le composent – l’Assemblée nationale et le Sénat. Il est cependant utile de rappeler ici que les pouvoirs et compétences qui seront examinés sont exercés séparément par chacune des Chambres, pour ce qui la concerne ; il n’existe pas (hormis le cas, extrêmement rare et déjà mentionné de la saisine de la Haute Cour pour juger le Président de la République, ou celui très théorique pour ce qui nous intéresse ici, du Congrès, réunion conjointe des deux Chambres pour valider une modification constitutionnelle, où les fonctions du Bureau de cette assemblée sont remplies par celui de l’Assemblée nationale) de cas où les autorités d’une Assemblée aient compétence sur les membres de l’autre.
Le Parlement français, juge du Président de la République, de ses membres et de son personnel, et maître de sa sécurité
Si l’autorité du Parlement français sur ses membres ne s’étend plus comme autrefois à la validation des mandats en début de législature ou à la capacité de prononcer la déchéance du mandat de ses membres, les Chambres sont toujours compétentes pour exercer leur autorité et sanctionner leurs membres pour leurs éventuels manquements au Règlement de l’Assemblée concernée.
En outre, tant en matière de marchés publics que d’autorité sur son personnel, les compétences du Parlement, pour être désormais soumises dans une certaine mesure au contrôle du juge administratif, demeurent cependant sensiblement plus larges que respectivement pour le code des marchés publics et le régime général du droit de la fonction publique, qui ne s’appliquent ni l’un ni l’autre au Parlement. Il peut d’ailleurs paraître paradoxal (mais cela est dû aux circonstances exceptionnelles qui ont prévalu lors de la création de la Vème République) que nombre de ces pouvoirs dérogatoires aux règles communément applicables relèvent d’une ordonnance (c’est-à-dire d’un texte législatif pris par voie règlementaire par le Gouvernement), l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
A. L’autonomie des pouvoirs de police
A la suite d’une tentative d’intimidation contre l’Assemblée nationale à ses tout débuts en 1789, celle-ci obtint d’assurer elle-même la police de ses travaux afin de garantir la liberté et la sincérité de ses délibérations. Ainsi aucune perquisition, aucune enquête de police, ne peut avoir lieu dans l’enceinte de l’assemblée, aucune force de police, aucun huissier de justice, ou encore un inspecteur du Travail, ne peut y pénétrer sans l’accord du Président. Ce sont également des personnels civils de l’Assemblée nationale et du Sénat, fonctionnaires recrutés par l’assemblée dont ils relèvent, qui sont chargés de la surveillance des accès du Palais-Bourbon (siège de l’Assemblée nationale), du Palais du Luxembourg (siège du Sénat) et des immeubles annexes.
Ultérieurement, la loi du 22 juillet 1879 conféra au Président de chaque assemblée le droit de requérir la force armée pour la garde de l’assemblée qu’il préside. En théorie, ce pouvoir est illimité, ce qui avait été déploré dans les débats de 1879, l’exécutif soulignant que le président d’une assemblée pouvait ainsi désorganiser la force armée par des exigences exagérées et imprévues, chacun d’entre eux pouvant demander « un régiment, une brigade, une armée »…
L’ordonnance du 17 novembre 1958 s’inscrit dans cette continuité historique : « les présidents des assemblées parlementaires sont chargés de veiller à le sureté intérieure et extérieure des assemblées qu’ils président. Ils peuvent, à cet effet, requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous les officiers et fonctionnaires, qui sont tenus d’y déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi ». On notera que ce droit de réquisition, qui peut être délégué aux Questeurs, ne doit, pour s’exercer, ni passer par l’intermédiaire du Gouvernement, d’un ministre, d’un militaire de haut rang, ou du Préfet de Police. Ainsi, le Président de l’Assemblée nationale, comme celui du Sénat, peut en théorie estimer seul les besoins de son assemblée en matière de sécurité, et requérir nommément les forces militaires ou de police dont il décide de s’entourer, qui doivent déférer sans délai à cet ordre. Même si ce sujet a perdu de son acuité, la France ayant connu jusqu’aux attentats récents une longe période de situation apaisée depuis la tentative avortée de coup d’État en 1961, il s’agit d’un élément très important pour les assemblées parlementaires, qui limite – certes à la marge, mais grâce seulement à la politique responsable constante des présidents des assemblées – le principe selon lequel les armées sont placées sous le commandement unique du Président de la République.
Selon le Règlement de l’Assemblée nationale, le Président fixe l’importance des forces militaires qu’il juge nécessaires, et celles-ci sont placées sous ses ordres. Il en va de même au Sénat. Le général, commandant militaire de la place, nommé par arrêté du Président de la Chambre et relevant de son autorité, dispose de personnels appartenant à la garde républicaine. Il définit et met en œuvre toute mesure militaire de surveillance et d’intervention aux abords du Palais et de ses annexes, et établit un contact permanent avec les services de la Préfecture de Police. Ainsi en pratique, les recours à la police ou à l’armée pour protéger le Parlement sont l’objet d’un consensus entre l’exécutif et le législatif, mais seulement sur la base d’une libre décision des présidents des Chambres.
En revanche, si l’accès des forces de police et de justice à l’enceinte de chaque Chambre est soumis à l’accord de son Président, le Parlement ne constitue en rien un espace d’ « exterritorialité », à l’opposé du territoire des représentations diplomatiques. Car le Parlement est clairement partie de l’État. Si un fait constituant un délit ou un crime de droit commun est commis par un parlementaire, ou toute autre personne dans l’enceinte de la Chambre, le Président doit en informer sans délai le procureur général, et faire retenir dans l’enceinte de la Chambre la personne suspectée des faits jusqu’à l’arrivée des juges et des policiers, à qui le Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat donnera alors accès aux locaux aux fins de perquisition et d’appréhension du ou des suspects.
Dans l’hypothèse toute théorique où il s’agirait d’un parlementaire, et sauf cas de flagrant délit, son arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté ne pourrait toutefois intervenir qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie (article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958).
B. L’autorité de la Chambre sur ses membres
Les fonctions électives ne sont pas considérées en France comme une profession, mais comme l’exercice d’un mandat. Néanmoins, les parlementaires sont soumis à une certaine discipline, dont les règles et les sanctions sont définies par le Règlement de chaque Chambre. Par commodité, il sera fait ici référence essentiellement à l’Assemblée nationale et aux députés qui la composent, des dispositions très similaires étant applicables au sein de la Chambre haute.
1. les dispositions visant à assurer l’assiduité des parlementaires aux travaux
En France, chaque parlementaire doit être membre d’une commission permanente (et d’une seule), aux travaux de laquelle il doit participer avec assiduité. C’est ainsi que l’article 42 du Règlement de l’Assemblée nationale dispose que la présence des commissaires aux réunions des commissions est obligatoire. Les noms des commissaires présents, ainsi que les noms de ceux qui se sont excusés, soit pour l’un des motifs prévus par l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, soit en raison d’un empêchement insurmontable, ou de ceux qui ont été valablement suppléés, sont publiés au Journal officiel le lendemain de chaque réunion de commission. Sauf exceptions, lorsqu’un commissaire a été absent à plus de deux des séances de la commission au cours d’une même mois et ne s’est ni excusé ni fait suppléer, chaque absence injustifiée à une réunion de commission lors de la matinée réservée aux travaux de celle-ci donne lieu à retenue d’¼ sur le montant mensuel de l’indemnité de fonction.
Force est de constater cependant que ces règles sont aujourd’hui très peu, voire jamais appliquées, et qu’un absentéisme important caractérise en France les réunions de la plupart des commissions parlementaires permanentes. En outre, dans la pratique, l’excuse est de fait acceptée, même sans que le parlementaire ait à apporter d’explication ou de justification, dès lors qu’elle est formulée par lui-même ou par l’un de ses collaborateurs au secrétariat de la commission. De plus, est noté comme présent tout parlementaire, pourvu qu’il soit au moins apparu, même brièvement, à la réunion de la commission dont il est membre. Cette situation, pour regrettable qu’elle soit, est due à une pratique ancienne de large cumul des mandats électifs, nationaux et locaux. Il n’était pas rare, il y a peu, qu’un député ou un sénateur soit également, par exemple, président de Conseil régional ou de Conseil général (aujourd’hui conseil départemental) et maire d’une grande ville, ce qui expliquait, sinon excusait, pour une large part son absence aux réunions de la commission parlementaire permanente dont il était membre. La récente décision de mettre fin au cumul des mandats pourrait être l’occasion d’appliquer de façon stricte ou tout du moins plus effective, à l’instar de certains autres pays d’Europe, des sanctions jusqu’ici largement théoriques.
Peut être plus efficace est la disposition relative à la présence des députés en séance publique. Même si l’absentéisme aux séances ordinaires ne donne pas lieu à sanction, un régime de retenue sur l’indemnité de fonction est applicable à ceux qui omettraient de participer régulièrement aux scrutins publics. Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée, des votes sur les motions de censure et des excuses présentées, le fait de n’avoir pris part, pendant une session, qu’à moins des deux tiers des scrutins publics auxquels il a été procédé en application du Règlement, entraine une retenue du tiers de l’indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session ; si le même député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée. Cette mesure au caractère principalement dissuasif, associée à l’organisation de l’ordre du jour de la semaine de travail parlementaire, qui inscrit souvent les scrutins publics importants après la séance de « Questions au Gouvernement » du mardi après midi, aboutit à une présence des parlementaires plus nombreuse qu’autrefois dans l’hémicycle lors de tels scrutins.
2. la sanction des comportements troublant l’ordre au sein de l’enceinte parlementaire
La Constitution du 4 octobre 1958 établit, comme il est de règle dans un régime démocratique, un principe d’immunité du parlementaire, tant du fait de son élection que dans l’exercice de ses fonctions. Son article 26 dispose qu’aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Cependant, l’exercice de cette liberté consubstantielle au mandat parlementaire ne saurait être compris comme le droit d’en détourner l’objet, notamment pour empêcher l’assemblée de fonctionner, troubler ses délibérations ou empêcher le libre exercice de leur mandat par les autres membres de la Chambre.
C’est pourquoi le règlement de l’Assemblée nationale prévoit, à son chapitre XIV (articles 70 à 78), un régime de sanctions graduées applicable à ceux des membres qui viendraient à troubler sérieusement la sérénité des débats et des délibérations.
Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont les suivantes :
- – le rappel à l’ordre,
- – le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal,
- – la censure,
- – la censure avec exclusion temporaire.
Conformément au règlement, l’autorité habilitée à prononcer un rappel à l’ordre est conférée au seul Président. Cette mesure disciplinaire, la moins grave dans la hiérarchie des sanctions, peut être prononcée contre tout orateur qui trouble cet ordre. Tout député qui, n’étant pas autorisé à parler, s’est fait rappeler à l’ordre, n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que le Président n’en décide autrement.
Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé contre tout député qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l’ordre, ou qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, des provocations ou des menaces.
Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité parlementaire.
La censure est prononcée contre tout député « multirécidiviste » dans son comportement de trouble à l’ordre dans l’hémicycle et qui, après un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, n’a pas déféré aux injonctions du Président. Elle peut également être prononcée contre tout député qui a provoqué une scène tumultueuse dans l’enceinte de l’Assemblée.
La censure avec exclusion temporaire du Palais de l’Assemblée peut être prononcée contre tout député :
- qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction
- qui, en séance publique, a fait appel à la violence
- qui s’est rendu coupable d’outrages envers l’Assemblée ou envers son Président
- qui s’est rendu coupable d’injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.
La censure avec exclusion temporaire entraine l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaitre dans le Palais de l’Assemblée jusqu’à l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.
En cas de refus du député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l’Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l’exclusion s’étend à trente jours de séance.
Comme indiqué plus haut, des dispositions très similaires sont prévues dans le règlement du Sénat (chapitre XVII du Règlement du Sénat).
Heureusement, les débordements sont extrêmement rares dans l’enceinte de l’Assemblée nationale, même si parfois le climat peut être tendu, notamment lorsque les débats se prolongent tard dans la nuit, ou sans discontinuer durant plusieurs jours. Cependant, des scènes tumultueuses ont été relevées à l’Assemblée nationale, à de rares occasions depuis les débuts de la Vème République : une fois au cours des années 1960, deux députés s’étaient battus en duel à l’épée, car l’un d’eux avait eu vis-à-vis de l’autre des propos peu amènes à l’égard de sa future épouse. Plus significatif, au milieu des années 1980, plusieurs parlementaires d’opposition s’étaient vus censurer pour provocation envers le Président de la République au cours des débats en séance publique. Il peut paraître paradoxal que l’immunité dont jouissent les députés dans leur expression et dans l’exercice de leur mandat, ne s’étende pas aux critiques à l’égard du Président de la République, d’autant que celui-ci est l’autorité politique la plus importante du pays. Mais cette disposition est tout d’abord le pendant de l’impossibilité institutionnelle du chef de l’État de répondre aux attaques dont il peut être l’objet. Ainsi, le Président de la République ne peut, pour des raisons historiques, pénétrer dans l’enceinte du Parlement, et donc a fortiori s’y exprimer. Par ailleurs, cette règle ne s’applique que pour des attaques à caractère personnel, et non lorsqu’il s’agit pour un parlementaire de critiquer ou de s’opposer, même avec véhémence, à la politique conduite par le premier magistrat de la République. Il faut d’ailleurs noter que, depuis 1974 (et cinq présidents de la République), seul un cas d’application de cette disposition a été observé, lors de la présidence de M. François Mitterrand.
Quant au Sénat, l’ambiance y est généralement plus feutrée qu’au sein de la Chambre basse.
En cas de voie de fait d’un membre de l’Assemblée à l’égard d’un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire.
A défaut du Président, le Bureau peut être saisi par écrit par un député. Dans ces conditions, lorsque la censure avec exclusion temporaire est proposée contre un député, le Président convoque le Bureau, qui entend ce député. Le Bureau peut appliquer une des peines prévues à l’article 70 (du simple rappel à l’ordre jusqu’à la censure avec exclusion temporaire).
Le Président communique au député la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le député est reconduit jusqu’à la porte du Palais par le chef des huissiers.
Hormis le cas qui précède, la censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l’Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur la proposition du Président.
Le député contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d’être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.
La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitié de l’indemnité allouée au député.
La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l’indemnité pendant deux mois.
En revanche, ainsi qu’évoqué plus haut, il n’existe pas aujourd’hui de possibilité pour une assemblée de prononcer l’exclusion définitive de l’un ou de plusieurs de ses membres.
Lorsqu’un député entreprend de paralyser la liberté des délibérations et des votes de l’Assemblée et, après s’être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d’obtempérer aux rappels à l’ordre du Président, celui-ci lève la séance et convoque le Bureau.
Le Bureau peut proposer à l’Assemblée de prononcer la peine de la censure avec exclusion temporaire, la privation de la moitié de l’indemnité parlementaire prévue par l’article précédent s’étendant dans ce cas à six mois.
En outre, si au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies de fait graves ont été commises, le Président saisit aussitôt le procureur général de la République.
La fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractère personnel du vote, entraine la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité versée au parlementaire. En cas de récidive pendant la même session, cette durée est portée à six mois. Le Bureau décide de l’application de l’alinéa précédent sur proposition des secrétaires, (ceux-ci étant les parlementaires chargés de veiller au bon déroulement des scrutins).
Si un fait délictueux est commis par un député dans l’enceinte du Palais pendant que l’Assemblée est en séance, la délibération en cours est suspendue. Séance tenante, le Président porte alors le fait à la connaissance de l’Assemblée. Si le fait visé est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance de l’Assemblée à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.
Le député est admis à s’expliquer, s’il le demande. Cependant, sur l’ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le Palais, le Bureau informant sur-le-champ le procureur général de la République qu’un délit vient d’être commis dans le Palais de l’Assemblée.. En cas de résistance du député ou de tumulte dans l’Assemblée, le règlement prévoit que le Président lève à l’instant la séance.
3. sanctions de l’utilisation abusive du titre de parlementaire
Il est interdit à tout député, sous les peines disciplinaires précitées, d’exciper ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l’exercice des professions libérales ou autres et, d’une façon générale, d’user de son titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat.
Il lui est également interdit, sous les mêmes peines, d’adhérer à une association ou à un groupement de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels ou de souscrire à l’égard de ceux-ci des engagements concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l’acceptation d’un mandat impératif, la Constitution interdisant tout mandat de cette nature.
4. conséquences du non-respect du secret des travaux des commissions d’enquête
Lorsqu’une commission d’enquête a décidé d’appliquer le principe du secret à ses travaux, les commissaires qui viendraient à communiquer à l’extérieur des informations dont ils auraient eu connaissance à l’occasion des travaux de cette commission en sont exclus par un vote de la Chambre sans débat, sur rapport de la commission après avoir entendu l’intéressé. Sans préjudice des sanctions pénales encourues, ils sont en outre passibles des sanctions disciplinaires précitées (du rappel à l’ordre à la censure avec exclusion temporaire). Dans l’un comme l’autre cas, la sanction entraine concomitamment l’interdiction d’être membre d’une autre commission d’enquête durant le reste de la législature (ou du mandat, s’il s’agit d’un sénateur).
C. L’autorité de la Chambre sur ses collaborateurs
L’indépendance du Parlement par rapport à l’exécutif entraine pour conséquence la totale indépendance de chaque Chambre dans la définition et l’exercice des conditions de recrutement et d’emploi des fonctionnaires et agents publics qui sont appelés à l’assister. Il en va donc également ainsi du régime et des modalités d’application des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées contre eux (qui vont du simple avertissement à la révocation, sans droit à pension). Quant aux collaborateurs politiques des parlementaires, des groupes politiques ou des présidents de commissions, ceux-ci sont liés directement aux élus ou à leurs groupes – sans intervention de l’assemblée dans laquelle ils travaillent, sauf pour leur rémunération – par un contrat de travail de droit privé (règle générale) ou de droit public (secrétaires généraux de groupes, assistants de présidents de commissions).
Le Président de chaque Chambre a, du point de vue législatif, la haute direction et le contrôle de tous les services de l’assemblée qu’il dirige. Au point de vue administratif, l’autorité sur les services appartient au Bureau ; la direction est assurée par les questeurs sous le contrôle du Bureau. Le Bureau détermine, par un règlement intérieur (différent du Règlement de l’Assemblée), l’organisation et le fonctionnement des services de l’assemblée considérée, les modalités d’exécution par les différents services des formalités prescrites par le Règlement ainsi que le statut du personnel.
Cependant, si la loi portant statut général de la Fonction publique exclut expressément les fonctionnaires parlementaires du champ de son application (comme pour les magistrats ou les militaires), un article de cette loi prévoit cependant que le statut des fonctionnaires parlementaires doit néanmoins respecter les principes généraux du droit et permet explicitement aux fonctionnaires de déferrer les décisions individuelles les concernant devant la juridiction administrative (en l’occurrence, le Tribunal administratif de Paris en première instance, et en appel le Conseil d’État).
D. Le Parlement érigé en tribunal et juge d’exception : la Haute Cour
Alors que le principe de séparation des pouvoirs constitue un principe constitutionnel (la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, incorporée à la Constitution de 1958 dans son préambule, dispose d’ailleurs qu’il n’est pas de véritable constitution sans séparation des pouvoirs), il peut paraître paradoxal que parmi les trois juridictions relevant de l’ordre constitutionnel (Conseil Constitutionnel, Cour de Justice de la République et Haute Cour), cette dernière soit la réunion du Parlement en formation de justice pour juger des actes du Président de la République. Ainsi, le pouvoir législatif est-il le juge suprême de la plus haute autorité du pouvoir exécutif.
Le principe de l’irresponsabilité juridique du Président de la République pour tous les actes qu’il accomplit durant son mandat – sauf en cas notamment de haute trahison – est durablement établi dans toutes les constitutions qu’a connues la France. Cependant, dans ce cas et jusqu’en 2007, l’article 68 de la Constitution du 4 octobre 1958 disposait que c’est à la Haute Cour de Justice, désignée au sein du Parlement, qu’il incombe de décider de la déchéance éventuelle du chef de l’État. Ainsi, même si l’hypothèse est heureusement particulièrement exceptionnelle, c’est au pouvoir législatif – et non à une Cour de l’autorité judiciaire – de prononcer cette mesure.
Cette formation reprenait pour l’essentiel la structure de la Haute Cour de Justice de la IIIème République, et celle mise en place à la Libération, dont les compétences étaient plus étendues puisqu’elle jugeait également les autres principaux dignitaires du « gouvernement de Vichy ».
En 1944, le gouvernement provisoire de la République française, s’inspirant des règles constitutionnelles de la IIIème République, confie en effet, dans les circonstances exceptionnelles de l’époque, à une Haute Cour de Justice composée très majoritairement de parlementaires le pouvoir de juger « les personnes qui, sous la dénomination de chef de l’État, chef du gouvernement, ministres, secrétaires d’État et sous-secrétaires d’État, commissaires généraux, secrétaires généraux du chef de l’État, du chef du gouvernement et des ministères, résidents généraux, gouverneurs généraux et hauts commissaires, avaient participé à l’activité des gouvernements de l’État français du 17 juin 1940 à août 1944. »
Compte tenu de la dissolution de fait du Parlement lorsqu’il met fin à la République et la remplace en 1940 par l’État français, la Haute Cour de Justice créée en 1944, est présidée par le premier président de la Cour de Cassation et assisté du président de la Chambre criminelle, ainsi que du premier président de la cour d’appel de Paris ». Elle est composée en outre de 24 membres, soit 12 sénateurs ou députés en cours de mandat à la déclaration de guerre, ayant refusé de voter les pleins pouvoirs à Philippe Pétain le 10 juillet 1940, et 12 membres de l’Assemblée consultative du Gouvernement Provisoire. À la suite des élections générales d’octobre 1945, la Haute Cour sera composée de 24 jurés, tirés au sort sur une liste de 96 députés de l’Assemblée nationale constituante, et de 3 magistrats.
Depuis la réforme constitutionnelle de 2007, ce sont l’ensemble des membres composant l’Assemblée nationale et le Sénat, qui constitués en Haute Cour (la mention « Haute Cour de Justice » a été supprimée) et qui peuvent destituer le Président de la République « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Si une loi organique a déterminé les procédures pour la mise en œuvre de cette déchéance, l’encadrant de solennité et évitant des abus par des votes à la majorité qualifiée, elle laisse en revanche le Parlement libre de déterminer ce qui pourrait constituer un tel « manquement ».
La Haute Cour, qui n’a heureusement jamais eu l’occasion de se réunir, correspond à un retour aux origines de ce rôle de juge du Parlement constitué, en tant que tel en tribunal, puisqu’à la différence de la Haute Cour de Justice, c’est désormais le Parlement dans son ensemble qui est juge. L’origine de ce « retour aux sources » doit être recherchée dans l’histoire des débuts de la République, lorsque la Convention (successeur de l’Assemblée nationale issue de la Révolution de 1789, et première assemblée élue au suffrage universel lors des élections de 1792) met en jugement devant elle, le 3 décembre 1792, le roi déchu Louis XVI, pour « intelligence avec les puissances ennemies ». Il est appelé à la barre de l’Assemblée les 11 et 23 décembre, et est assisté de trois avocats : Tronchet, Malesherbes et de Sèze. Sous l’impulsion notamment des Montagnards, le roi est déclaré coupable par 691 députés sur 718 le 15 janvier 1793. Le lendemain doit être rendu le jugement sur la peine à appliquer : 387 députés votent pour la mort et 334 pour la détention. Un contre appel est effectué le lendemain car il y a eu des modifications de vote : cette fois, on compte 361 voix pour la mort, contre 360 pour la détention.
Mais comme aujourd’hui, la distinction par la Constitution du rôle exact du Parlement dans l’acte de déchéance du chef de l’État et de la condamnation de la personne, reste floue.
Dans la période révolutionnaire certains députés, comme Just Rameau, représentant le département de la Côte d’Or, pourtant convaincus de la culpabilité du roi, veulent cependant distinguer l’acte politique décidant la déchéance du souverain, de la condamnation de l’homme, considérant que seule la première relève de la responsabilité de l’Assemblée. Il déclarera ainsi : «Alors, la Convention, oubliant le véritable objet de sa mission, et confondant le roi avec Capet, Capet avec le roi, se demande : Louis est il jugeable ? Puis, par qui doit il être jugé ? Et la voilà, sans en avoir le mandat spécial, transformée en tribunal criminel, et la sanction du souverain mise en question sur le jugement qu’elle pourra rendre, puis qui se culbute de précipitations en abus de pouvoir, de confusions de questions en pétitions de principe… » (Extrait du compte-rendu de la séance de la Convention nationale, décembre 1792)
Cette étude n’examinera pas le rôle du Parlement dans le jugement des membres du Gouvernement par la Cour de Justice de la République car celle-ci, composée certes majoritairement de parlementaires, ne fonctionne cependant pas comme une institution en tant que telle du pouvoir législatif.
II – L’intervention du Parlement dans le domaine judiciaire, et l’intervention de l’autorité judiciaire dans le fonctionnement du Parlement
L’intervention du Parlement dans le domaine judiciaire est de plusieurs ordres : il peut s’agir pour chaque assemblée de protéger ses membres et de garantir l’application des règles d’immunité dont ils bénéficient dans la Constitution. Cependant, notamment dans leurs relations aux tiers, des modifications récentes sont venues limiter quelque peu l’indépendance juridictionnelle traditionnelle des assemblées parlementaires, qui se sont vues en revanche confirmer leur capacité d’agir en justice.
Plus originale est l’existence d’une compétence du Parlement français de pouvoir reconnaître par la Loi la nullité de certains jugements ; ce droit d’amnistie s’analyse comme une capacité de déclarer inexistants certains délits, crimes ou contraventions commis, notamment afin de « pacifier » les tensions nées de certaines périodes troubles.
A. La garantie par l’assemblée des règles d’immunité de ses membres
L’article 26 précité de la Constitution française du 4 octobre 1958 dispose que, sauf en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive, aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont en outre suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. La mise en œuvre de ces dispositions est prévue par les articles 80 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, et par l’article 105 du Règlement du Sénat.
A l’Assemblée nationale, il est constitué, au début de la législature et, chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, une commission de quinze membres titulaires et de quinze membres suppléants, chargée de l’examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d’un député. Les nominations ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée nationale. Au Sénat, une commission de trente membres est nommée chaque fois qu’il y a lieu pour la Haute Assemblée d’examiner une proposition de résolution déposée en vue de requérir la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d’un sénateur.
La commission doit entendre l’auteur ou le premier signataire de la demande et le député intéressé ou le collègue qu’il a chargé de le représenter. Si le député intéressé est détenu, elle peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de l’article 26 de la Constitution, l’Assemblée se réunit de plein droit pour une séance supplémentaire pour examiner une demande de suspension de détention, de mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite.
Saisie d’une demande de suspension de la poursuite d’un député détenu ou faisant l’objet de mesures privatives ou restrictives de liberté, l’Assemblée peut ne décider que la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause.
B. L’autonomie écornée des assemblées vis-à-vis de la justice
Pendant longtemps, les décisions des assemblées parlementaires ont bénéficié d’une totale immunité juridictionnelle, qui a trouvé son fondement dans les principes révolutionnaires de séparation des pouvoirs et de suprématie du pouvoir législatif. Les actes des assemblées parlementaires ont donc longtemps échappé en principe à tout contrôle.
L’avènement de la Vème République en 1958 a maintenu ce principe d’immunité juridictionnelle, tout en l’assortissant de deux exceptions. Il est prévu, d’une part, que « l’État est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires » et que « les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes » (ordonnance précitée n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) et, d’autre part, que la juridiction administrative est appelée à connaître de tout litige d’ordre individuel concernant leurs agents, afin de mettre fin à ce qui était de plus en plus considéré comme un déni de justice. Il était, en effet, difficile d’admettre que les personnels ne pouvaient former de recours à la suite de décisions les affectant.
Ainsi, comme évoqué plus haut, dans la loi du 13 juillet 1983 portant statut de la Fonction publique, le législateur, d’ailleurs par une amendement d’initiative parlementaire, a tenu à rappeler que la juridiction administrative est compétente sur les litiges individuels intéressant les agents des assemblées au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires par la Constitution.
Par ailleurs, le Conseil d’État, dans un arrêt de 1987, a reconnu aux assemblées parlementaires le droit d’agir en justice. Le problème s’est posé de savoir si une assemblée parlementaire pouvait se représenter elle-même. Plusieurs tribunaux ont conclu en ce sens. L’Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale (texte pris en application du Règlement) intègre la capacité d’agir de l’Assemblée en disposant que la décision d’engager une procédure contentieuse est prise par son Président, sous la réserve que le Trésorier (qui est un fonctionnaire parlementaire) peut lui-même, après autorisation des Questeurs, diligenter toute procédure judiciaire ayant pour objet le recouvrement des créances de toute nature. D’après le règlement intérieur portant statut du personnel de l’Assemblée nationale, le Bureau est saisi des conflits entre l’administration de l’Assemblée et des personnes étrangères à celles-ci, les Questeurs étant autorisés à engager des actions judiciaires au nom du Président de l’Assemblée.
Un arrêt du Conseil d’État du 5 mars 1999 contredit l’ordonnance de 1958 et constitue une remise en cause nouvelle de l’immunité juridictionnelle des assemblées parlementaires, en étendant à l’ensemble des marchés publics le contrôle juridictionnel. En se déclarant compétent pour connaître de ces marchés, le Conseil d’État a toutefois précisé que les contrats litigieux n’étaient régis par le code des marchés publics qu’en l’absence de réglementation particulière édictée par les autorités compétentes de l’Assemblée nationale. Il a ainsi incité les assemblées à adopter une réglementation propre en matière de marchés, ce qu’elles ont fait en 2001. Il s’est agit là de la première manifestation, depuis plusieurs décennies, du pouvoir normatif des assemblées et donc de leur autonomie de gestion en dehors de ses champs traditionnels d’intervention (budget et personnel).
Ce pouvoir normatif aurait pu rencontrer certaines limites tenant, en particulier, au droit communautaire européen. Dans un arrêt de 1998, la Cour de Justice européenne a ainsi considéré qu’un organe législatif relevait de la notion d’État au sens des directives communautaires en matière de marchés publics de travaux. Elle a ajouté qu’un État membre ne pouvait tirer argument de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations prescrites par une directive.
D’ailleurs, dans la réglementation particulière qu’il a adoptée, le Bureau de l’Assemblée nationale n’a pas cherché à porter atteinte aux principes fondamentaux du droit des marchés publics, et les aménagements apportés à cette réglementation ont été finalement limités au strict nécessaire pour préserver l’autonomie des assemblées et prendre en compte les spécificités liées à leur organisation interne. Ainsi, la dérogation la plus importante apportée au code des marchés publics porte sur le caractère collégial de la personne responsable du marché – les Questeurs – et l’absence d’approbation ou de contrôle d’autorités extérieures à l’Assemblée nationale. La commission d’appel d’offres a en outre un rôle limité à l’ouverture et à la constatation du contenu des candidatures et des offres reçues par l’Assemblée. Cette commission n’émet pas d’avis à l’attention de la personne responsable du marché, sauf dans les cas où le code prévoit la présence de personnalités qualifiées. La minoration du rôle de la commission s’explique par le souci compréhensible de ne pas risquer de conflit entre les Questeurs, autorité politique, et une commission ne comportant que des fonctionnaires de l’assemblée concernée, qui leur sont subordonnés.
L’arrêt précité du Conseil d’État a constitué une remise en cause de l’immunité juridictionnelle traditionnelle des assemblées parlementaires pour l’ensemble des marchés publics passés par les assemblées. On peut de la sorte se demander si cette immunité juridictionnelle, qui n’était limitée dans l’ordonnance de 1958 qu’à deux cas précis, n’est pas désormais remise en cause dans d’autres domaines.
Il subsiste donc aujourd’hui une incertitude à propos de l’ampleur de ce contrôle juridictionnel, et il est difficile de déterminer a priori les actes entrant dans le champ du contrôle exercé par le juge administratif. C’est ainsi que le juge s’est également déclaré compétent pour connaître d’un litige entre le Sénat et certains de ses riverains, relatif à des aménagements opérés par la Haute Assemblée sur son domaine, au motif que ceux-ci avaient eu lieu sans permis de construire. Cette remise en cause de l’immunité juridictionnelle des assemblées était peut-être justifiable en opportunité, d’autant que la société actuelle assimile rapidement un traitement particulier à un traitement abusif ; néanmoins, toute immixtion du juge dans le fonctionnement des assemblées n’est pas nécessairement souhaitable pour autant car elle peut conduire à empêcher en pratique le Parlement d’exercer son pouvoir. Il est intéressant de noter cependant que la loi du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations publiques dispose que les actes des assemblées parlementaires ne sont pas considérés comme des documents administratifs au sens où cette loi l’entend.
C. La Loi au-dessus des décisions de justice : l’amnistie
L’amnistie est à l’origine une intervention du législateur, qui répond à un but d’apaisement social ; une loi décide d’effacer des crimes ou des délits de la mémoire collective, à des fins d’unité nationale. Comme la réhabilitation, elle est une mesure qui procède à l’extinction de la peine en même temps qu’à l’effacement de la condamnation prononcée. Elle a connu également en France, notamment depuis l’élection du Président de la République au suffrage universel et jusqu’à une époque récente, une évolution vers des considérations plus proches d’une « légalisation » de la pratique de la grâce présidentielle : pratiquement, chaque nouvelle élection d’un président de la République avait pour conséquence une loi d’amnistie, visant à mettre fin aux poursuites ou à effacer des contraventions ou délits mineurs, saluant ainsi par une mesure de clémence le début du mandat présidentiel.
L’amnistie est en fait une très vieille institution. L’Antiquité la connaissait déjà, le terme même provenant du nom donné par les Athéniens à la loi proposée par Thrasybule au Vème siècle avant l’ère chrétienne afin d’obtenir que les partis se réconcilient et oublient les querelles nées de la mesure d’expulsion portée contre les Trente (amnestia signifiant
« oubli et pardon »).
On s’est interrogé, notamment à la fin du XIXème siècle, sur le pouvoir qui devait détenir le droit d’octroyer l’amnistie. Cette dernière n’était-elle pas un droit régalien, ressortissant par conséquent aux prérogatives du chef de l’exécutif? La plupart des régimes autoritaires ont tranché d’ailleurs cette question à leur avantage, et ce fut le cas en France, notamment lors de la Restauration monarchique (1814-1815) et sous les deux Empires successifs ou, au cours du XXème siècle, durant le gouvernement de fait de Vichy, qui s’arrogea le pouvoir d’amnistie par l’acte dit « constitutionnel » du 11 juillet 1940. Au contraire, les régimes démocratiques préférèrent laisser le droit d’amnistie au pouvoir législatif, émanation de la Nation, arbitre général de toutes les mesures de paix et de sérénité sociale.
L’amnistie en France est régie par les articles 133-9, 133-10 et 133-11 du Code pénal. Il y est prévu que « l’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraine sans qu’elle puisse donner lieu à restitution la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure ». Les lois d’amnistie sont en France des lois ordinaires ; elles ne requièrent pas de majorité qualifiée et peuvent être soumises aux mêmes règles de contrôle de leur constitutionnalité que toute autre.
Il existe en France trois catégories d’amnistie :
- L’amnistie réelle, qui prend en compte des faits, en tenant compte de la nature ou de la gravité des infractions, ou qui se réfère à certaines circonstances ou évènements ;
- L’amnistie personnelle qui est liée à l’individu en fonction de sa qualité ou de son attitude particulière ;
- Enfin l’amnistie mixte qui prend en compte des éléments tenant aux faits et aux personnes en même temps.
La théorie parfois évoquée de l’illicéité de l’amnistie en droit international n’est pas retenue par les juges français. Dans une affaire, où une plainte avait été déposée contre l’auteur présumé de crimes contre l’humanité commis pour le compte des forces Vietminh de 1952 à 1954 sur la personne de prisonniers français, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris avait conclu que les faits incriminés tombaient sous le coup de l’amnistie proclamée par l’article 30 de la loi 66-409 du 18 juin 1966.
La Cour de cassation française a confirmé cette décision dans un arrêt du 1er avril 1993 qui affirme :
« Aucun principe constitutionnel, ni aucun principe de droit international, ne permet d’affirmer qu’une catégorie d’infractions serait, par nature, soustraite au pouvoir d’amnistie du législateur national. Celui-ci peut moduler l’ampleur et les modalités de chaque loi d’amnistie. Il peut choisir d’effacer non seulement des infractions vénielles, comme les contraventions, mais encore les infractions les plus graves, comme les crimes, et même les crimes contre l’humanité. »
Le droit français, qui reconnaît pourtant le caractère imprescriptible des crimes contre l’humanité, n’exclut donc pas la possibilité qu’ils soient susceptibles d’être amnistiés. En effet, la Cour de cassation précise que « le principe de l’imprescriptibilité de ces crimes constituant une dérogation exceptionnelle aux règles de procédure ordinaire, doit être restrictivement interprété ».
On comprend mieux ainsi pourquoi les juges français ne semblent pas considérer contraire aux engagements internationaux de la France la loi d’amnistie votée au lendemain de la guerre d’Algérie. Celle-ci a ainsi permis à la France d’amnistier pour elle-même les faits liés à cette guerre puisque la loi, votée au lendemain de l’indépendance de l’Algérie, a été votée par le Parlement français au profit des citoyens français sans consultation, contrairement aux accords d’Évian, des populations algériennes.
Deux plaintes pour crimes contre l’humanité ont été déposées en 1984 et 1985. Les juges d’instruction, confirmés par la chambre d’accusation, ont rendu une ordonnance de refus d’informer en constatant l’extinction de l’action publique par l’effet des lois d’amnistie de 1962. Dans ces deux affaires, la chambre d’accusation a estimé que « les ordonnances de non-lieu rendues lors des premières instructions sont définitives car motivées par l’amnistie, laquelle s’applique notamment aux infractions dénoncées comme crimes contre l’humanité qui sont des crimes de droit commun commis dans certaines circonstances et pour certains motifs précisés dans les textes qui les définit».
Mais de récents développements du droit international pourraient faire évoluer les choses, y compris en France : en effet, la Cour de cassation française, dans un arrêt du 23 octobre 2002 rendu dans l’affaire Ely Ould Dha, a estimé que « la loi mauritanienne du 14 juin 1993 portant amnistie ne saurait recevoir application sous peine de priver de toute portée le principe de compétence universelle ». En d’autres termes, la loi d’amnistie mauritanienne n’est pas opposable en France.
Longtemps, l’amnistie ne bénéficia qu’aux individus ayant commis des infractions effectivement énumérées par la loi; c’était l’amnistie dite réelle. Mais, pour pallier le défaut de l’aveuglement de la mesure, depuis 1919 est apparue une autre forme d’amnistie, l’amnistie personnelle. Parmi les grands textes d’amnistie, et sans compter les lois consécutives à une élection présidentielle, qui relèvent plus de la clémence ou d’un « don de joyeux avènement » inversé, signalons la loi du 16 août 1947 visant les auteurs de coalition de fonctionnaires, de rébellion, de négligence dans la garde des détenus, de bris de scellés, de dégradation de monuments publics, de vagabondage, de coups et blessures volontaires, de blessures ou d’homicide par imprudence, etc. ; la loi du 6 août 1953 amnistiant principalement certains individus condamnés pour collaboration avec l’ennemi; la loi du 31 juillet 1959, mesure adoptée en conséquence de l’avènement de la Vème République et amnistiant, notamment, les délits commis entre le 1er mai et le 28 septembre 1958, en rapport avec les évènements politiques d’alors ; les textes du 22 mars 1962 «portant amnistie des infractions commises au titre de l’insurrection algérienne» et «de faits commis dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre dirigées contre [celle-ci]»; la loi du 31 juillet 1968 portant «amnistie générale de toutes infractions commises en relation avec les évènements d’Algérie» ; celle du 2 mars 1982 «portant statut particulier de la région de Corse»; celles, encore, relatives à l’amnistie des militaires insurgés au cours de la guerre d’Algérie, les lois du 31 décembre 1985, du 9 novembre 1988 ou du 10 janvier 1990 relatives à la Nouvelle-Calédonie; celle encore du 15 janvier 1990, «relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques».
Il y a lieu également de rappeler l’amnistie ayant pour but de relâcher la pression de l’autorité publique sur le contribuable pour mieux l’amener à se mettre en règle avec la loi et à payer ce qu’il doit ; l’expérience en France tend cependant à être remplacée par un « délai de grâce » accordé par l’administration fiscale pour inciter les contrevenants à déclarer les sommes indument soustraites à l’impôt.
Conclusion
C’est le principe de l’indépendance du pouvoir législatif qui fonde la compétence du Parlement à pouvoir définir de façon autonome ses règles de fonctionnement, les sanctions encourues par ceux qui y contreviennent, et à prononcer lui-même des sanctions à l’encontre de ses membres et de leurs collaborateurs.
Si la Constitution de 1958 a retiré au Parlement le droit de sanctionner la validité des mandats de ses membres, et soumis pour le reste certaines de ses compétences de sanction à un contrôle de constitutionnalité et à un contrôle du juge, il n’en demeure pas moins que le régime de sanctions au sein des assemblées parlementaires déroge largement au droit commun. Il semble cependant que l’équilibre, parfois empirique, qui a été trouvé en France, tant par la Constitution que par la loi et la jurisprudence, mais aussi la pratique mesurée de leurs prérogatives par les autorités des assemblées parlementaires, protège à la fois l’indépendance du Parlement dans ce qu’elle a d’essentiel, et préserve les personnes soumises à son pouvoir de sanction, comme les tiers, des risques de déni de justice.
Certaines améliorations peuvent toujours être considérées souhaitables dans ce domaine comme dans d’autres ; il ne faudrait pourtant pas que la volonté de régler quelques cas particuliers, encore imparfaitement solutionnés dans les principes, remette en cause la primauté de la Loi et la possibilité pour le législateur d’exercer librement le mandat que le peuple lui a confié.