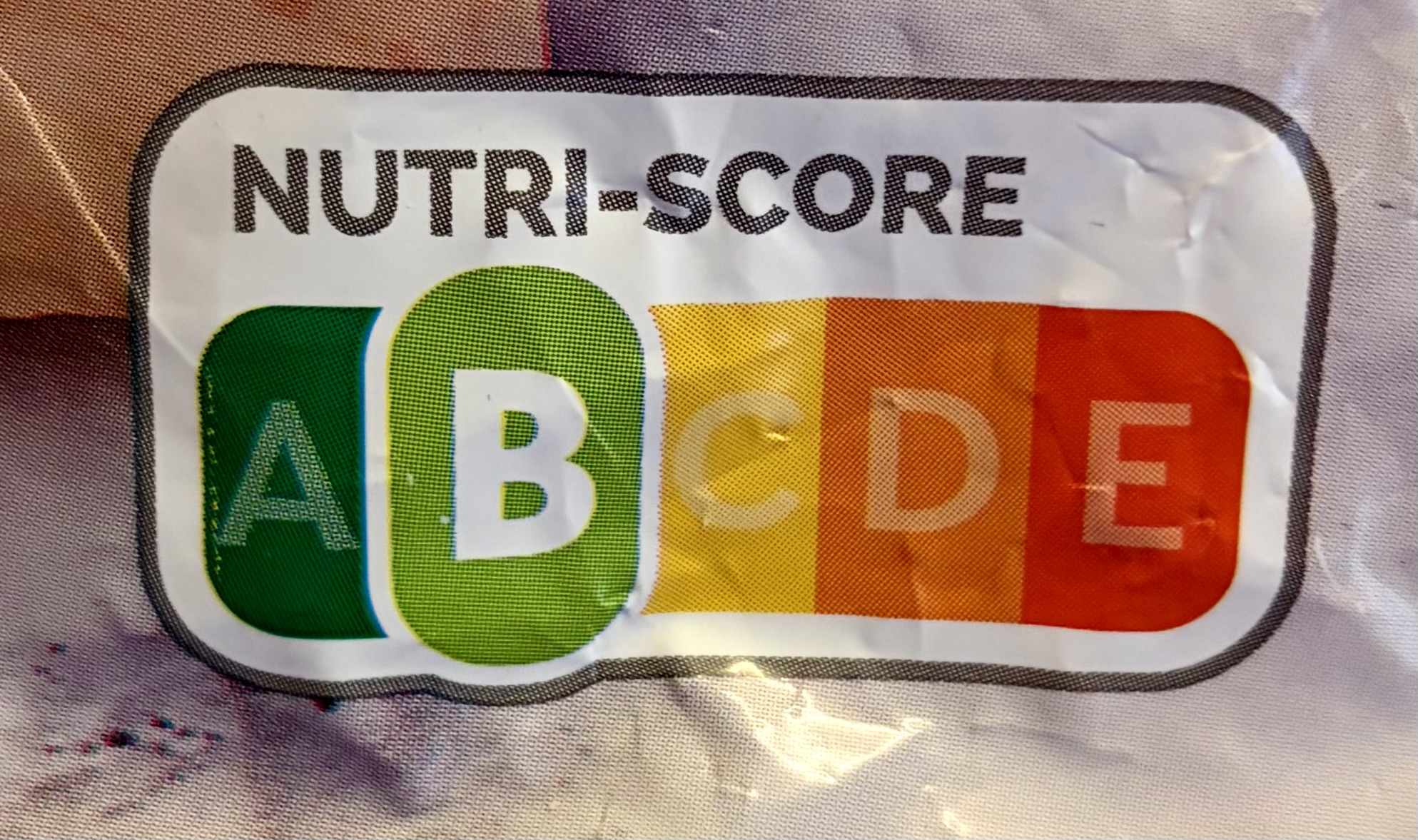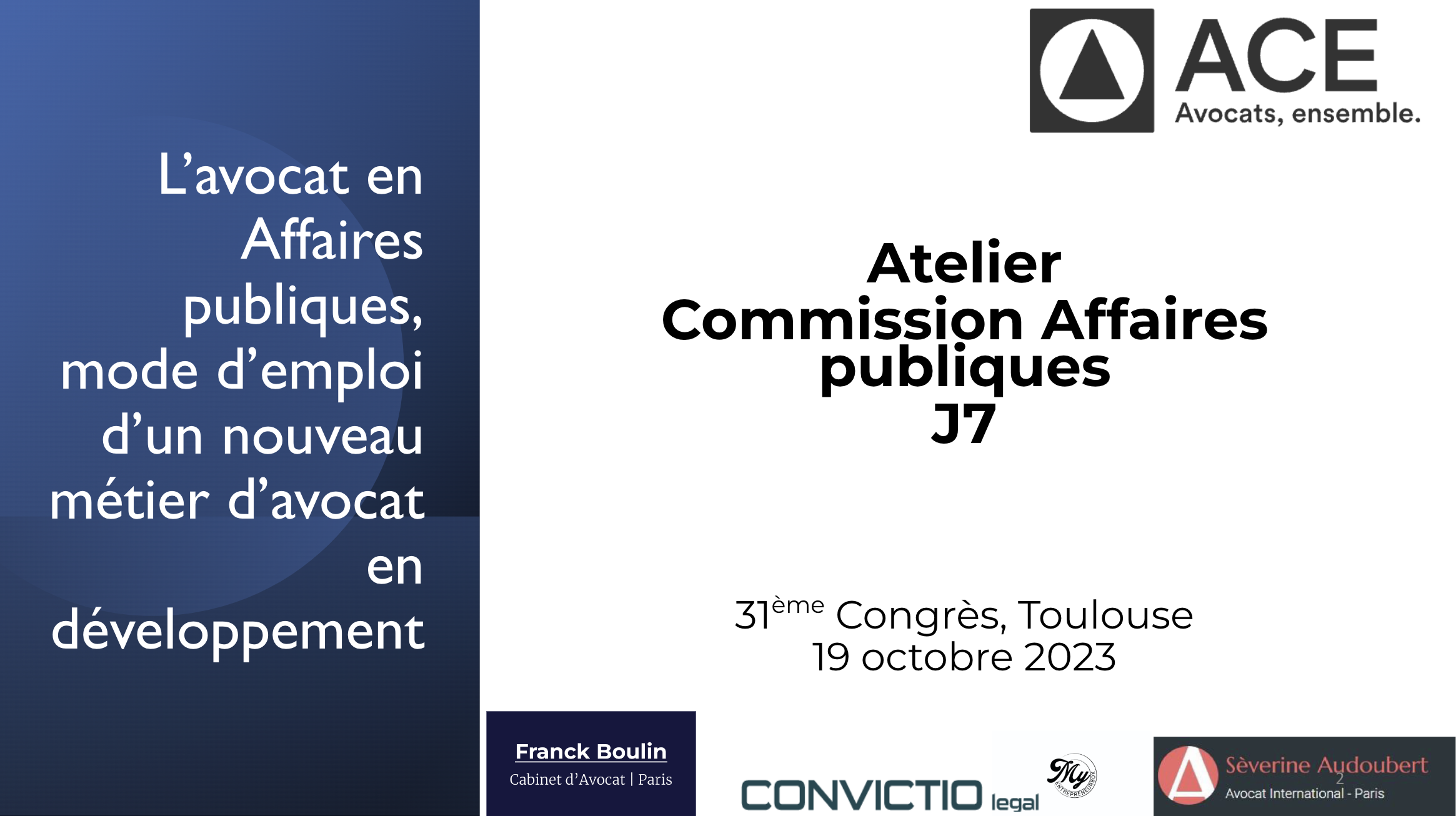À l’occasion d’un amendement à l’article 11 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS 2026) l’Assemblée nationale a entendu rendre obligatoire l’apposition du Nutri-Score sur les denrées alimentaires vendues en France.
Ce texte a été sous-amendé, excluant ainsi les AOP et AOC de cette mesure. Car le Nutri-Score, malgré ses intentions louables d’informer le consommateur, est devenu pour certaines filières, particulièrement celles ancrées dans la tradition et l’excellence gastronomique française, une source de friction. L’enjeu dépasse la simple notation. Il touche à la valorisation économique de productions spécifiques, à la préservation de savoir-faire ancestraux et, plus largement, à une certaine vision de l’identité culturelle et gastronomique.
Si à l’origine l’Union européenne, en adoptant le Règlement 1169/2011, visait à établir un logo nutritionnel unique qui aurait été rendu obligatoire, près de 15 ans après les divisions entre États membres, soucieux de préserver leur mode alimentaire, compris comme un enjeu autant commercial que culturel, ont abouti à une situation aussi bloquée qu’insatisfaisante, rendant impossible l’imposition d’un même logo dans les 27 États. C’est pourquoi les différents logos européens demeurent optionnels.
Les grandes entreprises de l’agroalimentaire s’opposent à son sujet. Or, dès lors que le score n’est apposé que comme signal d’appel, le risque est grand que les consommateurs en viennent rapidement à considérer le Nutri-Score, non comme une information indépendante mais comme une simple communication publicitaire.
Qu’est-ce que le Nutri-Score ?
Nutri-Score est l’un des trois principaux indicateurs d’information nutritionnelle existant dans l’Union européenne, avec le Nutrinform Battery et le Nøkkelhullet. Par rapport au Nutrinform Battery italien, son principal concurrent, présent comme lui dans 7 États européens, le Nutri-Score est simple et très facile à comprendre par le consommateur.
Il souffre cependant de l’inconvénient de fournir une information partielle, et parfois biaisée : qui consomme en effet 100ml d’huile d’olive, ou 100g de fromage à chaque repas ? En outre, il ne permet pas de disposer immédiatement d’une information ciblée sur les besoins quotidiens pour une alimentation équilibrée.
Cela n’a pas empêché depuis plusieurs années plusieurs tentatives d’apparaître à l’Assemblée nationale comme au Sénat qui visaient, comme l’amendement adopté dans la nuit du 7 au 8 novembre 2025 par l’Assemblée, à rendre le Nutri-Score obligatoire pour les denrées alimentaires vendues en France.
Leurs auteurs, à gauche comme à droite de l’échiquier politique, conscients qu’une telle mesure était contraire au Règlement communautaire précité, se sont souvent appuyés sur les dispositions, assez générales, de l’article 36 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui permet de restreindre la libre circulation des marchandises au sein du marché unique au nom de la protection de la santé humaine.
Une jurisprudence européenne
C’est méconnaître que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne encadre strictement les mesures nationales restrictives à la libre circulation des marchandises : celles-ci ne doivent ni discriminer arbitrairement ni masquer un protectionnisme, et leur nécessité doit être prouvée par l’État membre sur la base de risques scientifiquement évalués. En outre, ces dérogations sont soumises à un contrôle de proportionnalité afin de préserver la primauté de la libre circulation.
À cette aune, il serait donc difficile de justifier que tout produit alimentaire en provenance d’un des 26 autres États membres n’arborant pas un Nutri-Score constituerait un risque sanitaire suffisamment impérieux pour en interdire l’accès au marché français.
C’est probablement pour cette raison que l’amendement adopté ces derniers jours à l’Assemblée nationale a adroitement, plutôt qu’à chercher à imposer le Nutri-Score sur tous les produits alimentaires, créé une taxe nouvelle de 5% sur le chiffre d’affaires, affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie, frappant toutes les entreprises mettant sur le marché français des denrées alimentaires. Rappelons que ce dernier terme, tel que défini dans le Règlement (CE) 178/2002, recouvre « toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain. »
Compte-tenu de son assiette universelle, le rendement de cette taxe devrait donc normalement suffire à combler la plupart du déficit du régime de santé (13,8 milliards d’euros en 2024). La production en valeur de l’industrie agroalimentaire française ayant atteint 206,5 milliards d’euros en 2023, le rendement annuel de cette taxe serait ainsi de plus de 10 milliards d’euros.
En réalité, il est difficile de justifier l’assiette de cette taxe. La rédaction de cet amendement assujettirait ainsi pour l’ensemble de leur activité LVMH, dont l’essentiel de la production porte sur le luxe et la mode mais qui vend également des vins et spiritueux, ou encore SANOFI, une entreprise pharmaceutique produisant également des compléments alimentaires entrant dans le champ de la définition des « denrées alimentaires ». L’objectif n’est donc pas d’augmenter les recettes de l’État.
Le Nutri-Score obligatoire
Car cette taxe cache une astuce : rendre de fait le Nutri-Score obligatoire, tout en escomptant respecter le cadre européen. Un alinéa de l’amendement prévoit ainsi d’exonérer de cette contribution les entreprises appliquant « les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique ».
À première vue, la manœuvre semble assurée : la France imposerait le Nutri-Score sans enfreindre le Règlement européen qui, à ce jour, n’autorise que des scores nutritionnels facultatifs.
Pourtant, il n’en est rien. Le code de la santé publique ne va en effet pas aussi loin que l’analyse l’amendement : il n’impose que la déclaration de composition des aliments, aucunement le Nutri-Score, ni autre « présentation ou expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles », toujours facultative.
L’amendement ne modifie donc en rien la situation actuelle.
Un leadership par l’amélioration pour sortir de l’ornière actuelle
Plutôt qu’essayer d’imposer le Nutri-Score par des subterfuges législatifs, la France dispose d’une légitimité historique et d’un poids politique indéniable pour impulser une nouvelle dynamique en matière d’information du consommateur et de promotion d’une alimentation saine et équilibrée.
Le blocage actuel au niveau de l’Union européenne, couplé aux contestations internes croissantes, crée une situation où une initiative française audacieuse pourrait s’avérer décisive.
En proposant une version rénovée du Nutri-Score qui intègre de manière réfléchie et argumentée les critiques fondées – qu’elles concernent la prise en compte des produits du terroir, l’impact des portions, ou les ajustements fins suggérés par des instances scientifiques comme l’Agence nationale de Sécurité sanitaire (ANSES) – la France ne se contenterait pas de défendre « son » système. Elle le ferait évoluer pour répondre à des préoccupations plus larges, potentiellement partagées par une majorité d’États membres.
Une telle démarche permettrait à la France de se positionner non plus comme le défenseur intransigeant d’un outil perfectible, mais comme un leader pragmatique et innovant, capable de catalyser un consensus. Un Nutri-Score réformé à l’initiative de la France pourrait alors devenir la nouvelle référence, plus équilibrée et acceptable, pour une future harmonisation européenne.
Cela redonnerait à la France un rôle moteur sur les questions de politique alimentaire et de santé publique à l’échelle de l’UE. Le retard initial de la France dans l’application du nouvel algorithme du Nutri-Score, désormais en vigueur depuis mars 2025, peut même être rétrospectivement interprété comme un temps nécessaire à la maturation d’une réflexion plus approfondie, visant précisément à intégrer ces améliorations substantielles avant de chercher à l’imposer plus largement.
Cette posture de « leadership par l’amélioration » serait une voie stratégique pour sortir de l’ornière actuelle.